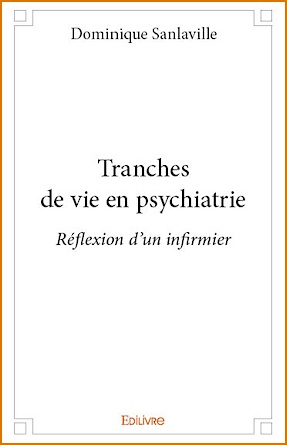 Tranches de vie en psychiatrie
Tranches de vie en psychiatrie
Réflexions d’un infirmier
Par Dominique Sanlaville
SOMMAIRE
Infirmier en psychiatrie depuis 1977, j’ai voulu réaliser un travail de réflexion sur l’évolution de la pratique de la psychiatrie en France. Au travers de quelques cas, au travers de la vie d’un hôpital, des services que j’ai connus et des collègues et des malades que j’ai rencontrés, j’ai essayé de transmettre mon expérience et surtout de mettre en évidence ce qui me semble indispensable dans la relation avec le malade.
Une psychiatrie déshumanisée
Des anecdotes, des textes simples à lire, abordables par tous et même parfois volontairement humoristiques présentent ce monde obscur de la psychiatrie qui fait peur, mais qui est souvent le reflet de celui des gens normaux. Des cas concrets illustrent les différentes pathologies. Et au fil des pages, se dessine cette réflexion qui définit ce que doit être le soin. C’est aussi l’histoire de cette psychiatrie qui s’est peu à peu dépsychiatrisée, déshumanisée…
Disparition de la psychothérapie
La façon de comprendre, de considérer et d’accepter la maladie mentale a beaucoup changé. Les impératifs budgétaires, les protocoles et une médicalisation trop importante ont réduit peu à peu l’activité du soignant à des gestes techniques aseptisés et rentables financièrement. La psychothérapie a disparu, le mot inconscient n’est même plus prononcé. Les électrochocs et les attaches reviennent en force. On ne prend plus le temps d’écouter et de comprendre le patient, de connaître son histoire et celle, intimement liée, de sa maladie. Il faut surtout le normaliser, effacer ses symptômes pour qu’il ressorte au plus vite avec souvent comme seule aide, son traitement médicamenteux.
Le mal être en psychiatrie ne concernerait pas que les patients
On a oublié que c’est la relation qui est porteuse du soin. Et sans cette relation thérapeutique, le travail de l’infirmier risque d’être vidé de son sens. En fin de carrière, j’ai l’impression que ce métier n’est plus fait pour moi, je m’y sens mal et parfois même, il m’arrive de ne pas être fier de ce que je fais… Je constate que mes jeunes collègues ne sont plus motivé(e)s et veulent s’en aller. Le mal être en psychiatrie ne concernerait donc plus seulement que les patients.
Titre: Tranches de vie en psychiatrie
Auteur: Dominique Sanlaville
Editeur: Editions Edilivres
Parution: Juillet 2016
Pages: 218
Format: papier 17,50 euros
Format: numérique 1,99 euros
EXTRAIT 1
Le priapisme en psychiatrie
Il avait 30 ans environ et était assez fier de lui, de son physique. Il soignait son apparence. Comme tout cycliste qui se respecte, il s’épilait et s’huilait généreusement tout le corps. Pour qu’on l’admire, il restait volontiers en short et le torse dévêtu une partie de la journée.
Si pour lui cela ne représentait qu’un détail, il était quand même arrivé à l’hôpital en placement d’office, suite à des violences envers sa femme et envers les forces de l’ordre. Et comme ce n’était pas la première fois, il y avait des chances pour que le juge se montre beaucoup moins clément. Mais cette réalité-là ne semblait pas l’affecter. De même qu’il s’accommodait parfaitement de l’interdiction de quitter sa chambre et d’avoir des visites. Il organisait ses journées en les rendant trépidantes d’activités : d’abord prendre soin de lui, de son corps, ce qui l’occupait longtemps. Et mettre de l’ordre dans ses papiers et faire ses courriers. Il usait une quantité incroyable de feuilles et d’enveloppes. On lui postait tous les jours de nombreuses lettres adressées à des gens importants, directeurs de ceci, directeurs de cela, commissaires, avocats et huissiers, etc. Il notait nos noms et nous assurait de pouvoir intervenir en « haut lieu » pour nous obtenir des avancements, des bonifications… Il prenait son traitement sans trop rechigner mais n’appréciait pas du tout le médecin et ne se cachait pas pour le dire.
Drôle de personnage qui tentait, un peu désespérément, de garder la maîtrise sur tout ce qui lui arrivait. On sentait bien qu’à la moindre étincelle, ça pouvait exploser d’un coup ! C’est ce qui arriva et pour une cause tellement futile : l’oubli d’un de ses médicaments et certainement pas volontaire de sa part. Mais lorsque l’infirmière présente lui en a fait la remarque, il l’a frappée sans pouvoir se retenir.
Il s’est donc retrouvé contenu sur son lit. Ce qui était très rare à cette époque, il avait d’ailleurs fallu que l’on quémande des attaches dans un autre service. Mais même dans ces conditions, il ne lâchait rien de sa superbe. Il continuait à faire le beau, à se croire supérieur, comme s’il était au-dessus de tout ça. Le médecin donna comme consigne de le laisser le plus longtemps possible seul dans sa chambre, de ne pas répondre à ses appels, de l’ignorer, pour le faire déprimer un peu et l’obliger à descendre de son piédestal. Il avait les mains et les pieds attachés, il allait bien trouver autre chose pour se manifester !
Et il déclara donc une crise de priapisme. La chose forcément excita les curiosités. Ils furent nombreux à défiler pour aller se rendre compte, infirmiers, médecins, internes… Il avait réussi à avoir du monde autour de lui et il y prenait réellement un certain plaisir.
On connait assez mal les mécanismes et les causes du priapisme. Il y en a tant. Chez notre sujet, la pratique intensive du vélo avait certainement joué. Mais la chose arrivait tellement à point nommé qu’on ne pouvait douter d’une large participation psychique.
Dans le priapisme s’exprime un désir de puissance virile dans lequel le sexe pourrait être vu de plus longue taille qu’il ne l’est réellement. Il est curieux d’ailleurs de remarquer que les hommes de pouvoir ont souvent un appétit sexuel démesuré, comme s’ils confondaient la capacité à gouverner avec leur puissance sexuelle. Henri IV, le roi aux 75 maitresses, surnommé le « vert galant » vénérait le priapisme et cru jusqu’à 50 ans que c’était « un os ». Félix Faure, qui toute sa vie a voulu vivre César est mort Pompée au cours d’une énième fellation réalisée par sa maîtresse. Exception qui confirme la règle, Hitler, quant à lui, a souffert de ne pas pouvoir faire « führer » au lit avec son micro pénis de 7 cm tout mouillé de chaud. La chronique actuelle n’a pas fini de décrire encore et encore la folie sexuelle des hommes politiques. Le sexe représente le potentiel générateur, symbole de la continuité, de la force de vie, la puissance et la gloire…
Sauf qu’après un certain laps temps, le priapisme devient douloureux. Et notre patient qui continuait à exhiber son « baculum » sans aucune pudeur, ne s’y attendait pas ! Le plaisir tourna au drame, et rien que le poids du drap devenait insupportable… Le médecin ne manqua pas de lui annoncer à ce moment-là précisément, que le priapisme est une réelle urgence chirurgicale. Si l’on n’intervient pas dans les quatre heures, il y a un risque d’impuissance irréversible. On se risqua à essayer les glaçons, mais mise à part lui tirer des abominables cris de douleurs, c’était inefficace sur l’érection. Il fallut donc l’emmener aux urgences et l’accompagner, étant donné son placement.
Il partit sur son brancard avec le drap en toile de tente qui battait la mesure suivant son rythme cardiaque. Il fut observé encore maintes fois par tout un panel de médecins, chirurgiens, etc. Mais maintenant, il n’y prenait plus aucun plaisir et il implorait qu’on le délivre le plus vite possible.
L’intervention eut lieu dans la soirée. Il en est ressorti effondré physiquement et moralement. Il n’était plus le même. C’était comme si on l’avait changé. Il était tombé d’un coup de la certitude dans le doute et il pleurait comme un petit enfant. Avec la ponction de la verge, son « hypertrophie du moi » s’était dégonflée. Le geste chirurgical avait bien marché !
EXTRAIT 2
Le bonheur forcé
Paul était un brave garçon, toujours célibataire à 40 ans. Il était bien connu dans le village. Il pouvait rendre service aux uns ou aux autres, et encore travailler dur s’il le fallait ; plus jeune il avait même été pompier volontaire. Employé quelques années dans une usine de fonderie, on l’avait renvoyé pour inaptitude et mis en invalidité. Son problème, c’était l’alcool. Il ne buvait pas tout le temps, mais suffisamment pour ne pas pouvoir conserver un emploi.
Quand il faisait la tournée des deux ou trois bistrots du village, il terminait régulièrement son périple sous le même banc public près de la mairie. L’ennui, quand il avait picolé, c’est qu’il devenait vite parano. Calme, intelligent et plaisant à jeun, et tellement gentil, il se montrait agité, outrancier et vulgaire sous alcool. Comme la majorité des gens qui boivent d’ailleurs. Alors on préférait le voir saoul complètement, plutôt qu’entre deux vins. Donc on ne lui refusait jamais aucun verre.
Pendant longtemps, on l’a très bien toléré dans le village, lui et ses exactions d’alcoolique. Même quand il avait eu l’idée de s’acheter une mobylette et qu’il lui fallait toute la route pour regagner son domicile ou qu’il s’aplatait dans les fossés.
Il louait deux pièces en haut du village, sans aucun confort. C’était sale, pas chauffé l’hiver et rempli, comme il disait, de « cadavres de bouteilles ». Mais il s’en contentait. Paul, il ne réclamait pas grand-chose ! Sous alcool, il criait, il vitupérait, il ouvrait la bonde à son réservoir de revendications ; il lui fallait ça et ensuite il décuitait et retrouvait un comportement normal, adapté, sociable et respectueux.
Un jour une assistante sociale zélée, récemment employée à l’hôpital, s’offusqua en l’apercevant sous son banc. Et elle parvint à décider notre médecin de l’hospitaliser. Nous sommes donc partis le cueillir.
-« On ne peut pas le laisser, disait-elle, c’est inhumain ! »
Paul a donc fait ainsi son entrée dans le monde de la psychiatrie. Au bout de quelques mois sans alcool et avec une alimentation correcte et des soins d’hygiène, il se refit une santé. À quel point était-il dépendant de l’alcool ? On lui accorda des permissions, mais quelques-unes furent des occasions de nouvelles alcoolisations massives. Les sorties non accompagnées furent donc supprimées. On le mit sous tutelle et on liquida son appartement. Peu à peu, Paul s’habitua à sa nouvelle vie. Il y trouva bien quelques avantages. Mais quand il parlait de lui, c’était toujours de son passé – de ce qu’il avait fait avant – comme s’il ne pouvait pas ou n’osait pas regarder trop loin devant.
Rosette, elle, vivait en ville, dans un des bas quartiers. Un rez-de-chaussée sinistre et froid, logement qu’elle avait gardé de ses parents mais qui était devenu insalubre. Elle y habitait seule, avec sa kyrielle de chats. Elle n’avait pas eu une superbe vie, Rosette, elle était marquée, à peine 40 ans et déjà les cheveux tous gris, une bouche édentée. Elle avait connu les privations et les sévices de tous ordres. Son père buvait et l’avait violée et tapée, lui et certainement beaucoup d’autres d’ailleurs. Une pauvre fille qui, malgré tout, savait garder son sourire, même si très souvent elle se faisait avoir en accueillant avec gentillesse des bons à rien qui profitaient d’elle. Dans la plus grande pièce, sur un tas de matelas empilés, vivaient les chats, en nombre incalculable. Les portées devaient se succéder. Rosette nettoyait bien les excréments, mais ça empestait fort l’urine de chat partout. Bien sûr qu’elle se privait pour ses chats et qu’elle ne mangeait pas tous les jours à sa faim ! Elle devait supporter le froid, et tous les importuns qui, ne sachant où dormir, venaient squatter chez elle. Mais c’était sa vie, et, elle existait à travers ça, elle avait sa place dans le quartier, elle connaissait tout le monde, voisins et commerçants.
Pour elle aussi, notre assistante sociale décida que :
-« Non, on ne pouvait pas la laisser dans ce taudis ! »
Et on lui permit de faire aussi son entrée dans la psychiatrie. Petite cure de jouvence ou « relooking » : elle fut lavée et récurée, ses cheveux teintés et coiffés et sa bouche reçut les soins nécessaires (extractions complètes et pose d’un dentier). Elle rajeunit de dix ans. On la mit sous tutelle et on liquida son appartement. Elle ne se plaignait pas Rosette. Nous étions devenus ses nouveaux amis et elle nous témoignait beaucoup d’affection, elle nous appelait « mes petits chéris ». Mais parfois, elle pleurait en repensant à son appartement, à sa vie d’avant, pourtant si difficile, mais qui avait quand même des bons côtés. À l’hôpital, quelque chose lui manquait…
On les garda quelques années en bonne santé tous les deux. Ensuite le vent tourna en psychiatrie. Par mesure d’économie, il fallait vider des lits. Pour Rosette et Paul, comme pour un grand nombre de patients, on devait trouver une solution, un point de chute, un lieu de vie. Une maison de retraite perdue dans la campagne roannaise, offrait son agrandissement à la psychiatrie. Alors les dérogations d’âge furent accordées à profusion. De tous les services, des malades y partirent très rapidement.
Ainsi Paul et Rosette réunirent leurs affaires. C’est-à-dire pratiquement rien. Toute leur vie se résumait dans un ou deux sacs en plastique noir de l’hôpital, sacs poubelles détournés de leur usage.
La maison de retraite était réellement éloignée de tout, dans un hameau sans âme, à des dizaines de kilomètres de la première agglomération et du premier magasin. Le bâtiment venait d’être entouré d’une haute barrière grillagée toute neuve, avec, à l’entrée, une caméra de surveillance. L’écran de contrôle était dans le bureau du directeur. Le règlement interdisait toute sortie extérieure non accompagnée. On avait formidablement bien anticipé l’arrivée des malades de psychiatrie !
Paul survécut de très longues années sans avaler aucune goutte d’alcool, en tuant le temps avec des mots fléchés, des mots casés et un peu de télévision. De sa fenêtre, la vue portait loin sur la jolie campagne environnante. Il n’a pas eu de visite à part les nôtres, deux ou trois comprises dans le service après-vente. Il est décédé finalement d’un infarctus. Il aurait pu mourir bien plus jeune sous son banc et à cause de l’alcool. On peut dire qu’on lui a sauvé la vie !
Rosette est devenue assez vieille, elle a eu le temps de beaucoup pleurer en repensant à son quartier mal famé, à son appartement malsain, à ses chats, et à toutes ses mauvaises fréquentations, mais, grâce à nous, bien au chaud et bien nourrie.
Ceci laisse à penser que l’hôpital parfois, avec tous ses soins bien intentionnés, est peut-être pire que la rue et que l’on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. J’étais encore élève lorsqu’en service, un patient avait fugué. On savait tous parfaitement où il se rendait. Car ce n’était pas la première fois. Il allait souvent rôder autour des barrages. Et puis ce jour-là, il a sauté, du côté du vide. J’étais scandalisé parce que personne n’avait bougé… Je ne connaissais pas trop ce patient. Depuis des années, il était torturé par ses angoisses schizophréniques. Avec le recul, je me dis que l’équipe avait respecté son suicide, la fin de ses souffrances épouvantables contre lesquelles on était bien impuissant. Ce métier doit nous apprendre à rester humble, à reconnaître les limites de nos soins.
Titre: Tranches de vie en psychiatrie
Auteur: Dominique Sanlaville
Editeur: Editions Edilivres
Tweet



