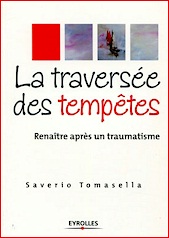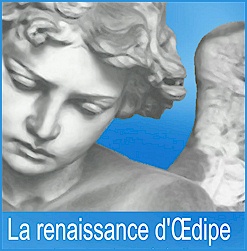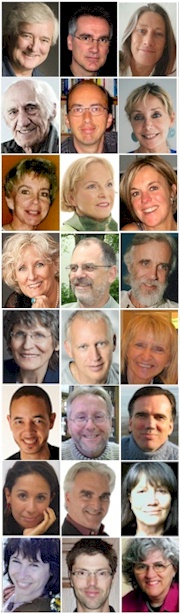Melanie Klein, née en 1882 à Vienne et décédée en 1960 à Londres, est une psychanalyste britannique d’origine autrichienne. Elle fut le chef de file d’un mouvement psychanalytique anglais qui a promu la psychanalyse des enfants avec un cadre de traitement strictement psychanalytique à l’opposé de celui d’Anna Freud qui préconisait un cadre plus « éducatif ». Ses travaux ont profondément marqué le mouvement analytique et pas seulement pour les dissensions qu’ils ont créés. Elle s’est attachée à analyser la psyché dans ses dimensions « archaïques », « primaire » ou quel que soit le terme qu’on veuille lui attribuer. C’est certainement et en grande partie grâce à Klein, ses disciples et surtout leurs théories appliquées que la psychanalyse a pu s’ouvrir à des champs de psychopathologie plus large, notamment les psychoses. L’ampleur de ses apports a été grandement obscurci dans la période où elle exerçait en Grande-Bretagne et où une sorte de guerre idéologique surdéterminée par des luttes d’influence, la rivalité avec la fille de Freud, etc… Elle a largement contribué à entretenir ces conflits qui n’ont plus cours aujourd’hui ou beaucoup moins. Des aspects théoriques radicaux du corpus, des pratiques techniques pour le moins hardies restent discutées mais le cœur de l’œuvre: ses découvertes sur les mécanismes archaïques (position schizo-paranoïde, position dépressive, identification projective, destructivité, réparation, etc., etc. sont très souvent présentes dans la plupart des énoncés et des pratiques1 de psychanalystes actuels, de manière peut-être moins prégnante chez les lacaniens. À ce sujet il n’est pas inutile de rappeler que Donald Winnicott qui est certainement plus populaire que Mélanie Klein a été supervisé par M. Klein, sans parler de Wilfred Bion qui s’est appuyé sur les théories de celle qui a aussi été son analyste pour développer sa propre pensée. L’école argentine (Bleger, Garma, Grinberg, Barranger, etc.) s’est elle aussi largement inspirée des œuvres de M. Klein. Parmi les élèves directs on trouve des psychanalystes comme Donald Meltzer, Herbert Rosenfeld, Hanna Segal (qui est celle qui facilité l’accès aux écrits compliqués et touffus de M. Klein), John Steiner pour ne citer qu’eux.
Elle fit une première psychanalyse avec Sándor Ferenczi et devient membre de la Société Psychanalytique de Budapest. Après une seconde psychanalyse menée par Karl Abraham faite à Berlin, elle part pour l’Angleterre et vivra à Londres jusqu’à sa mort.
Mélanie Klein a été une personnalité aussi riche que controversée, lorsqu’elle était en désaccord avec d’autres analystes, dont sa propre fille, elle se montrait intransigeante. Quant à la technique de la cure qu’elle promouvait, elle était d’une rigueur extrême. Son style d’interprétation était très particulier car elle se montrait directe et était loin de l’attitude silencieuse de certains analystes freudiens qui pensaient qu’il « fallait laisser le patient faire son analyse lui-même » ! En France cette attitude était courante ce qui fait que l’accueil qu’on lui a réservé a été assez discret, Jacques Lacan l’appelait la « tripière géniale », André Green qui connaît bien son œuvre a intitulé un article de livre qui lui était consacré « Trop c’est trop » 2. Il est de bon ton de dire de manière consensuelle qu’elle a contribué à développer les concepts issus de l’œuvre de Sigmund Freud mais elle a certainement fait plus ou dans une autre direction. Willy Baranger a pu lui affirmer qu’elle avait trop le souci de « coller » aux théories de Freud et que ça l’a freinée notamment en complexifiant et en alourdissant ses textes réputés laborieux. Il pense même qu’elle aurait mieux fait d’aller au bout de ses idées en se préoccupant moins de se référer à Freud parfois de manière acrobatique3, c’est selon lui la psychanalyse dans son ensemble qui en aurait alors bénéficié.
L’apport et les travaux de Melanie Klein
Concepts
– position paranoïde-schizoïde
— clivage de l’objet, objet partiel, parents combinés
— identification projective
— envie
– position dépressive clivage de l’objet,
— objet total
— gratitude (psychanalyse)
– technique du jeu (psychanalyse)
Influence
Melanie Klein s’est d’abord consacrée à la psychanalyse des enfants, qui s’est considérablement développée depuis dans plusieurs directions.
Wilfred Bion élabora sa conception d’une identification projective pathologique menant à la formation d’objets bizarres, et qui se distingue d’une identification projective normale.
Donald Winnicott travailla sur la relation d’objet primaire, qu’il distingue de l’utilisation de l’objet, concevant notamment la notion d’objet transitionnel.
Bibliographie extraite de Wikipédia. – http://fr.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein
Ses principaux ouvrages
– Essais de psychanalyse (1921-1945) (Payot 1968)
– Développement de la psychanalyse.(1948) P.U.F. 1966
– La psychanalyse des enfants.(1932) P.U.F. 1969
– Psychanalyse d’un enfant.(1947) Tchou 1973
Quelques citations
Si au fond de notre inconscient, nous sommes devenus capables d’effacer dans une certaine mesure les griefs ressentis contre nos parents, nous pouvons alors être en paix avec nous même et aimer les autres dans le vrai sens du mot.
Mélanie Klein, extrait de : « L’Amour et la haine : Le besoin de réparation. »
Le sculpteur qui met la vie dans ses objets d’art, que ceux-ci représentent ou non une personne, restaure et recrée inconsciemment les personnes autrefois aimées, qu’il a détruites en fantasme.
Mélanie Klein, extrait de : « L’Amour et la haine : Le besoin de réparation. »
Mon travail psychanalytique m’a convaincu que, lorsque l’esprit de l’enfant des conflits entre l’amour et la haine se posent, et les craintes de perdre l’être aimé devient actif, une étape très importante est faite dans le développement.
Melanie Klein
Une des nombreuses expériences intéressantes et surprenantes du débutant à l’analyse des enfants est de trouver chez les enfants, même très jeunes une capacité de vision qui est souvent bien supérieure à celle des adultes.
Mélanie Klein
Tweet